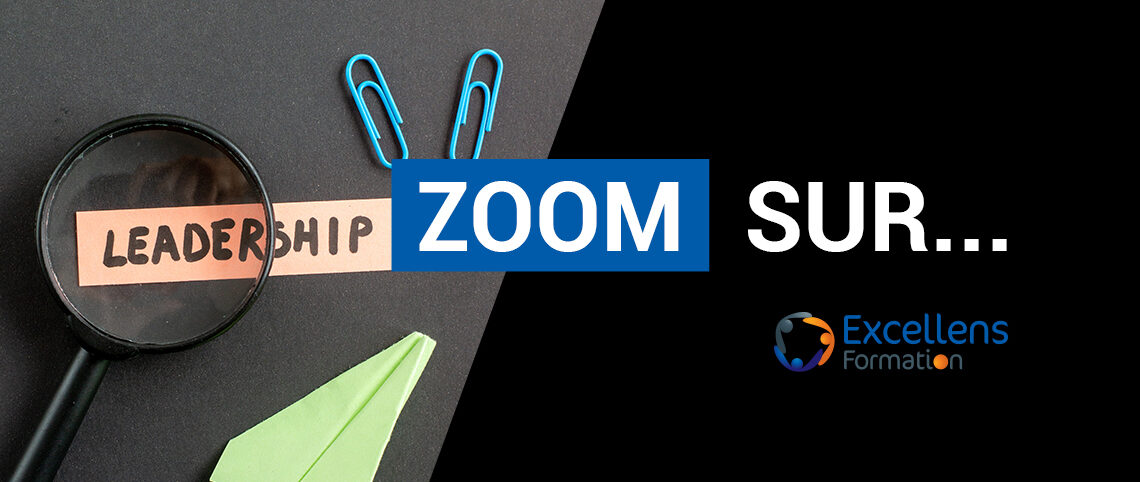« L’impression d’être pris en étau entre la hiérarchie et les équipes. » Cette phrase revient fréquemment dans les formations management et résume parfaitement la réalité de nombreux managers publics aujourd’hui.
Les risques psychosociaux ne sont plus un sujet tabou dans la fonction publique. Cependant, entre les rapports alarmants et les injonctions à développer le bien-être au travail, beaucoup de managers se sentent démunis face aux enjeux concrets. Comment s’y prendre efficacement quand il faut déjà gérer les contraintes budgétaires, les réformes permanentes et des équipes parfois épuisées ?
L’accompagnement de centaines de managers d’organismes publics (CNRS, Sécurité Sociale, collectivités territoriales) révèle une réalité encourageante : la prévention des RPS s’acquiert par des méthodes structurées et s’avère moins complexe qu’anticipé.
Identifier les signaux d’alarme précurseurs
Ces indicateurs subtils qui révèlent la souffrance
Dans les formations, une question revient systématiquement : « Comment reconnaître qu’un manager traverse une période difficile ? » Les réponses sont révélatrices : irritabilité inhabituelle, isolement progressif, retards récurrents, modification des habitudes professionnelles…
Ces signaux, tous les professionnels les connaissent. Pourtant, la tendance consiste souvent à les minimiser ou à les attribuer à des facteurs externes. « C’est une mauvaise période », « Il traverse des difficultés personnelles », « Elle n’est peut-être pas adaptée à ce poste »… Cependant, dans 80% des cas, ces comportements révèlent un manager en situation de souffrance professionnelle.
Dans la fonction publique, le phénomène s’avère particulièrement insidieux. La culture du service public pousse souvent les managers à négliger leur propre bien-être. Conséquence ? Ils maintiennent leurs performances jusqu’à l’épuisement complet.
Les défis spécifiques du secteur public
Les managers publics évoluent dans un environnement particulièrement contraint. Ils doivent optimiser les ressources disponibles, innover dans des cadres réglementaires rigides, et justifier constamment les décisions prises. Cette situation génère une fatigue mentale considérable.
L’exemple d’une responsable de service social accompagnée récemment illustre parfaitement cette problématique : « L’impression d’être prise entre deux feux : la direction demande de réduire les coûts, les usagers attendent davantage de services, et les agents sont démotivés par les suppressions de postes. »
Ce témoignage, sous différentes formes, se retrouve dans l’ensemble des secteurs publics. Hôpitaux, collectivités, administrations centrales… partout, les managers vivent cette tension permanente entre mission de service public et contraintes de gestion.
L’enjeu consiste à intervenir avant la rupture. Lorsqu’un manager s’effondre, c’est l’ensemble du service qui en subit les conséquences.
Stratégies de prévention éprouvées
Instaurer un dialogue constructif
La communication constitue le premier levier de prévention des RPS. Cependant, cette approche nécessite une méthode structurée pour éviter les écueils. Trop de managers organisent des temps d’écoute qui se transforment en séances de défoulement collectif par manque de préparation.
Le principe fondamental ? Montrer l’exemple en reconnaissant ses propres difficultés. Un manager qui admet traverser une période compliquée autorise ses collaborateurs à exprimer leurs propres préoccupations. Cette transparence s’avère libératrice pour l’ensemble de l’équipe.
Marie, DRH dans une collectivité de 500 agents, a expérimenté cette approche. Elle a introduit un temps d’écoute en début de réunion d’équipe avec une question simple : « Comment vous sentez-vous cette semaine ? » Résultat mesurable : en trois mois, les arrêts maladie ont diminué de 30% dans son service.
L’objectif n’est pas de transformer le bureau en cabinet de consultation, mais de créer un environnement où les difficultés peuvent s’exprimer sans jugement.
Optimiser l’organisation sans révolutionner
La réorganisation du travail constitue un levier fréquemment évoqué pour prévenir les RPS. Dans le secteur public, les contraintes semblent insurmontables : missions obligatoires, effectifs contraints, procédures réglementaires…
Pourtant, des marges d’amélioration existent. Chez certains organismes du CNRS, le travail s’est concentré sur la « charge mentale invisible » : l’accumulation de petites tâches qui encombrent l’esprit. La mise en place d’un simple tableau partagé recensant les responsabilités de chacun a permis de réduire le stress de 40% selon leur enquête interne.
La stratégie gagnante ? Identifier les « irritants du quotidien » plutôt que de chercher la transformation radicale. Cette réunion qui pourrait être remplacée par un échange écrit, ce reporting redondant, cette procédure inutilement complexe… Chaque amélioration, même minime, contribue au mieux-être collectif.
Restaurer le sens du travail
« À quoi sert concrètement notre action ? » Cette interrogation revient fréquemment dans les services publics, particulièrement quand les agents ont l’impression de consacrer plus de temps aux procédures qu’au service aux usagers.
Un directeur d’hôpital a développé une méthode simple mais efficace : il affiche dans tous les services les témoignages de patients satisfaits. « Cela rappelle notre utilité sociale », explique-t-il. Dans son établissement, le taux d’engagement des soignants a considérablement progressé.
La même logique s’applique dans l’administration : rappeler régulièrement l’impact concret du travail de chacun. Cette demande d’aide sociale traitée permet à une famille de se loger. Ce dossier de subvention validé permet à une association de poursuivre son action. Ce permis de construire délivré concrétise un projet de vie.
Boîte à outils pratique pour managers
Le tableau de bord de vigilance
Surveiller la santé de son équipe ne nécessite pas de compétences statistiques avancées. Un système de veille simple, le « tableau de bord 5 minutes », s’avère particulièrement efficace.
Chaque semaine, noter :
- Qui a pris des congés ou RTT de dernière minute ?
- Combien de fois des propos défaitistes ont été entendus ?
- Qui évite les moments de convivialité ?
- Combien de tensions interpersonnelles ont nécessité une intervention ?
Si plusieurs indicateurs se révèlent préoccupants, le moment d’agir est arrivé. L’intervention immédiate prévaut sur l’attentisme.
La méthode des entretiens de régulation
L’entretien annuel d’évaluation ne constitue pas le moment approprié pour aborder le bien-être au travail. L’instauration d’entretiens de régulation mensuels de 15 minutes maximum s’avère plus pertinente. Le principe : évaluer le ressenti sur une échelle de 1 à 10 et identifier les leviers d’amélioration.
Souvent, les demandes s’avèrent simples : anticipation des urgences, organisation séquentielle des dossiers, explication des évolutions procédurales… Ces ajustements mineurs constituent de la prévention pure et coûtent considérablement moins qu’un arrêt de longue durée.
Protocole de gestion de crise
Malgré toute la prévention mise en place, certaines situations dégénèrent. Un agent en détresse, une équipe qui s’effondre… Dans ces moments critiques, la réactivité prime sur la réflexion.
La méthode « STOP » structure l’intervention d’urgence :
- Sécuriser : extraire la personne de la situation stressante
- Temps : accorder un délai de récupération (jour de récupération, télétravail…)
- Outils : mobiliser les ressources spécialisées (médecine du travail, psychologue, formation…)
- Plan : organiser conjointement un retour progressif
L’essentiel ? Ne pas endosser le rôle de thérapeute, mais assurer une présence bienveillante et orienter vers les compétences appropriées.
Transformer l’environnement de travail
Convaincre la hiérarchie par les résultats
« Mon responsable considère que l’attention portée au bien-être nuit à la performance. » Cette préoccupation revient fréquemment. La solution consiste à adopter le langage de la direction.
Éviter : « Il faut développer la prévention des RPS. » Préférer : « Nos indicateurs de performance se dégradent en raison de l’absentéisme. Quelques actions ciblées permettraient d’inverser la tendance. »
Avec des données concrètes : « Un investissement de 2 jours de formation management peut éviter 15 jours d’arrêt maladie annuels. » Cette approche pragmatique trouve davantage d’écho.
Créer une dynamique d’amélioration continue
Le management bienveillant se propage par l’exemple, mais nécessite du temps pour s’installer. Chez certains clients, la démarche a commencé par la formation de trois managers volontaires. Six mois plus tard, dix autres sollicitaient la même formation.
Le facteur de succès ? Valoriser les réussites obtenues. Quand une équipe retrouve sa sérénité grâce à son manager, il faut le mesurer, le communiquer, le partager. Ces « success stories » internes motivent les autres managers à s’engager dans la démarche.
L’organisation de temps d’échange entre managers renforce cette dynamique. Rien ne vaut le témoignage d’un collègue pour expliquer comment il gère ses situations difficiles.
Mesurer les progrès sans complexifier
L’évaluation des actions menées reste importante, sans nécessiter une expertise technique poussée. Quelques indicateurs simples suffisent :
Évolution sur 6 mois :
- Taux d’absentéisme de l’équipe
- Satisfaction des usagers (si disponible)
- Niveau de stress personnel (échelle de 1 à 10)
- Fréquence des dysfonctionnements à régler hebdomadairement
L’objectif consiste à observer la tendance. Si elle s’améliore, poursuivre les efforts. Si elle stagne, ajuster les méthodes. Du pragmatisme avant tout.
Vers un changement durable
Prévenir les RPS ne relève ni de l’angélisme ni de l’effet de mode managériale, mais du pragmatisme pur. Des managers épanouis génèrent des équipes performantes, qui assurent un service public de qualité. L’équation reste simple.
Certes, la transformation de la fonction publique ne s’opérera pas du jour au lendemain. Mais chaque action compte : cette conversation bienveillante avec un agent en difficulté, cette réorganisation qui simplifie le quotidien, cette reconnaissance exprimée au bon moment…
D’ailleurs, les formations se concluent toujours par cette question : « Quelle action sera mise en place dès lundi ? » Parce que la difficulté principale consiste souvent à commencer. Mais une fois initié au management bienveillant, difficile de revenir aux anciennes pratiques.
La question reste ouverte : par quelle action commencer ?
Pour aller plus loin dans la prévention des RPS
Excellens Formation accompagne depuis plus de 17 ans les managers publics dans cette transformation. Les formations « Management bienveillant » et « Prévention des RPS » sont conçues sur mesure pour les spécificités du secteur public.
Un échange sur vos besoins spécifiques ? Contactez-nous : contact@excellensformation.com